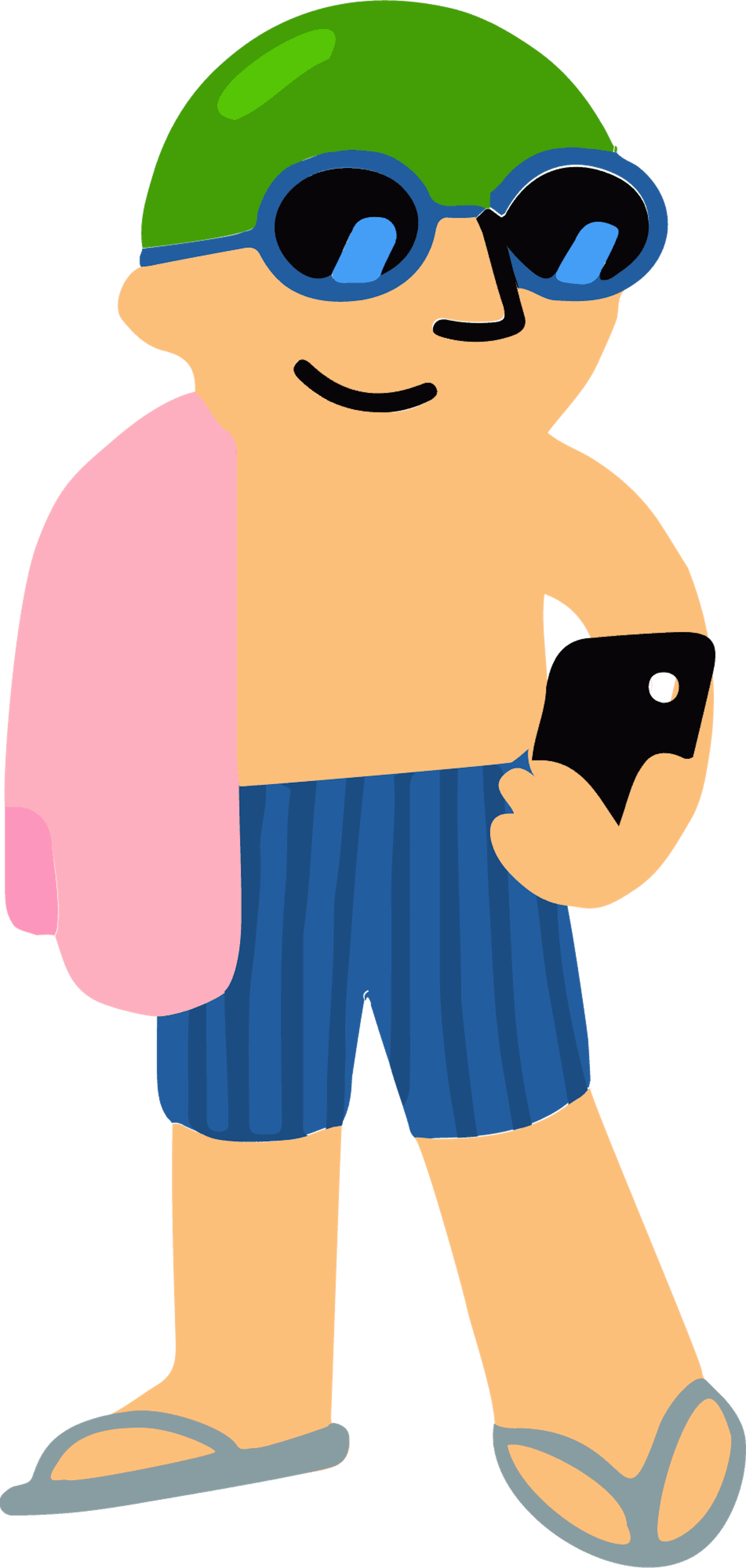Code de la rue : quels sont ses principes ?
Connaissez-vous le code de la rue ? Savez-vous qu’il a été créé pour mieux protéger les usagers plus vulnérables jusqu’au centre des villes ? Qu’il prend en compte les dimensions écologiques et économiques de la conduite ? On vous dit tout sur ce dispositif de 2008, plus responsable et respectueux.
Le code de la rue : de quoi parle-t-on ?
Il s’agit d’un dispositif mis en place en 2008 après le constat de la grande vulnérabilité des autres usagers de la route en interaction avec les véhicules de type voitures ou poids lourds. Le nombre d’accidents graves ou mortels dont elles étaient les victimes finit par interpeller les pouvoirs publics. Jusqu’alors, le code de la route donnait la priorité à la fluidité du trafic automobile.

Les usagers vulnérables sont identifiés comme ceux n’ayant pas ou peu de dispositifs de protection autour d’eux, donc étant particulièrement exposés en cas de collision, notamment les enfants et les personnes âgées.
Code de la rue : différences avec le code de la route
Le code de la rue est un dispositif complémentaire venant enrichir le code de la route. Il développe les notions suivantes :
- pour réduire les accidents : la nécessité d'accroître la vigilance par rapport aux usagers vulnérables ;
- le renforcement des mesures de sécurité visant ces usagers, comme la signalisation, les feux, des règles de stationnement et de circulation spécifiques pour les automobilistes et les utilisateurs d’engins de la mobilité urbaine, l’instauration du port obligatoire d’un gilet de sécurité pour les cyclistes ;
- la prise en compte de l’écologie via le développement de modes de circulation plus durables.

L’essentiel du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008
Ce décret apporte au code de la route des modifications à la conduite et à l’aménagement urbain, consolidant les mesures antérieures comme :
- la réduction de la vitesse en zone urbaine ;
- la création d’aires piétonnes ;
- la création de zones 30.
Le décret instaure également un nouvel espace : la zone de rencontre.
Il a été complété et renforcé par le décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 qui introduit le respect du piéton traversant la chaussée. Les années suivantes ont vu la mise en place d’autres dispositions, dont en 2015 le stationnement très gênant et les sanctions associées, plus sévères.
Pour fluidifier la mobilité urbaine, les transports en commun comme les bus et les tramways possèdent aussi leurs propres règles de priorité. Quelques exemples : les transports en commun peuvent disposer de leurs propres feux tricolores, certaines portions de la voirie leurs sont dédiées, ils sont prioritaires sur tous les usagers (automobilistes, cyclistes, etc.) lorsqu’ils quittent leurs arrêts, etc.
Quels sont les 3 types de zones de circulation du code de la rue ?
Le décret distingue 3 zones urbaines de circulation en fonction de leur dangerosité en termes de sécurité routière.
L’aire piétonne
Tout comme le trottoir, cette zone est entièrement dédiée aux piétons. Sa réglementation garantit la priorité des piétons sur tous les véhicules, à l’exception des transports en commun tels que les tramways. Les cyclistes, les usagers d'engins individuels de la mobilité urbaine (trottinettes, etc.) et les véhicules étant autorisés à y circuler doivent rouler au pas. Le stationnement y est totalement interdit.

La zone 30
Comme son nom l’indique, la vitesse y est limitée à 30 km/h. La vitesse représente le premier facteur d’accident de la circulation et est un vecteur majeur de leur gravité. Ainsi, une zone de limitation à une vitesse si basse apporte une importante garantie de sécurité.

La zone de rencontre
Contrairement à la zone 30, la zone de rencontre est une section de la voirie entièrement dédiée aux piétons.Tous les usagers peuvent y circuler : automobilistes, cyclistes, engins de la mobilité urbaine, etc. Par contre, dans ces aménagements spécifiques, la réglementation stipule que les piétons peuvent traverser la chaussée là où ils le veulent et qu’ils sont prioritaires sur tous les autres usagers (sauf sur le tramway).

Les pistes cyclables sont aussi des aménagements prévus pour les usagers vulnérables. La réglementation indique que les cyclistes y sont prioritaires. Par contre, les règles du code de la route pour les vélos sont les mêmes que celles des automobilistes en dehors des pistes. Notamment en termes de priorité aux feux tricolores ou dans un carrefour. Attention aussi aux usagers (cyclistes et motos) qui circulent entre une file de voitures continue. Les accidents y sont nombreux. Soyez vigilants et placez-vous le plus à gauche pour être vu des automobilistes !
La signalisation des zones urbaines de circulation et son périmètre de validité
Des panneaux spécifiques signalent l’entrée dans chaque zone. Les règles qui s’y attachent restent valables jusqu’au panneau de fin de zone. Cela signifie que lorsque vous tournez à une intersection après avoir dépassé un panneau de zone 30 par exemple, vous devez continuer à rouler à 30 km/h après votre changement de direction.
S’il existe des portions de voirie où les usagers vulnérables (piétons, cyclistes et utilisateurs d’engins de mobilité urbaine) sont protégés, certaines leurs sont interdites. C’est le cas des voies rapides et voies express où seuls les automobilistes, transports en commun et poids-lourds sont autorisés. Les risques d’accidents y sont bien trop grands.
Origines des nouvelles dispositions pour mieux protéger certains usagers
Bien que l’on vous parle de « nouvelles dispositions », il faut admettre que la situation des usagers vulnérables a retenu l’attention des pouvoirs publics depuis les années 1990. Les premières mesures prises ont concerné des réductions de vitesse en agglomération, d’abord à 60 km/h, puis à 50 km/h.
L’idée et le dispositif du « code de la rue » ont trouvé leurs sources dans une expérimentation réalisée en Belgique, qui visait à réduire le nombre d’accidents urbains. À partir de là, une association, Rue de l’Avenir, a publié en 2005 un fascicule intitulé « Code de la rue dans le code de la route ». Cette démarche a provoqué une nouvelle réflexion, qui a débouché sur le décret de 2008.
L’action de cette association, rejointe par d’autres, n’a pas faibli dans les années qui ont suivi. Elles sont même arrivées, petit à petit, à détrôner la raison du plus fort et à faire entrer dans la loi un partage plus équitable et sécurisé de l’espace public.